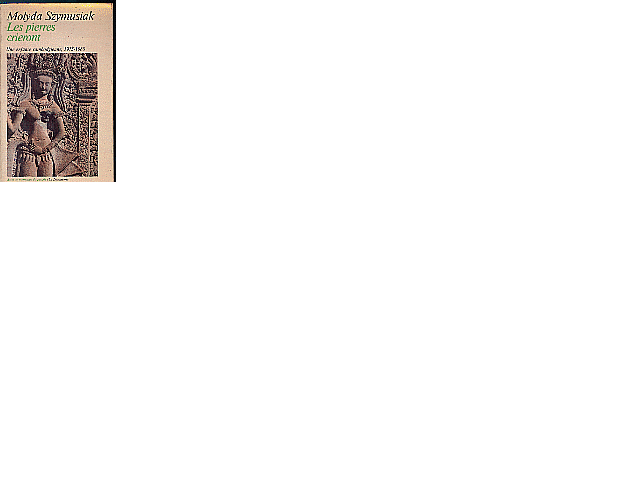 Unique survivante de sa famille, Molyda a dicté à
ses parents adoptifs le récit de l'agonie des siens sous
le régime des Khmers rouges. Elle avait douze ans lorsque
les troupes de Pol Pot occupèrent Phnom Penh le 17 avril
1975.
Unique survivante de sa famille, Molyda a dicté à
ses parents adoptifs le récit de l'agonie des siens sous
le régime des Khmers rouges. Elle avait douze ans lorsque
les troupes de Pol Pot occupèrent Phnom Penh le 17 avril
1975.
Le récit est accablant par sa simplicité. Ce n'est
pas une prise de parole politique, mais l'égrènement
impitoyable de longues journées de faim, de peur, de silence,
de travail forcé. Il débouche sur l'espérance
d'un nouveau départ dans la vie sur un sol hospitalier.
Une famille s'est reconstituée, auprès de parents
européens, avec deux autres enfants rescapés.
Ce témoignage constitue un document historique capital,
d'abord parce qu'il s'agit du premier récit de l''intérieur
qui couvre toute la période du régime Pol Pot, jusqu'à
l'arrivée des Vietnamiens. Surtout, par la précision
de ses détails, ce livre apporte des éléments
d'explication inédits de ce qui restera comme l'une des
plus tragiques aberrations de l'histoire de l'humanité.
Mais c'est aussi la chronique d'une expérience psychologique
peu banale. Cette dernière dimension n'est pas la moins
importante : elle peut aider à expliquer la survie d'une
enfant tout aussi exposée que les autres, et peutêtre
même plus fragile, mais qui n'a jamais perdu confiance en
l'avenir.
Extrait N° 1 : Evacuation de Phnom Penh
Trois jours après mon escapade, c'était le 16 avril
1975, de sinistre mémoire : le plus gros bombardement dont
je me souvienne : ça brûlait de partout, de la fumée
plein le ciel, des explosions dans tous les quartiers de la ville.
A ma famille, composée de mes parents, de quatre filles
dont j'étais la seconde, et d'un petit frère de
quatre ans, s'était jointe la famille de Mitia Mir, mon
oncle, qui était l'époux de la soeur plus jeune
de ma mère, et de leurs neuf enfants, dont l'aînée,
Tôn Ny, avait onze ans, la plus jeune Sreï Peu, un
an et demi. Nous avons passé ensemble la journée
dans une profonde tranchée que l'on avait creusée
au fond du jardin.
C'est là tout près que mon père et mon oncle
enterrèrent une carabine et un pistolet qui étaient
des souvenirs de famille et qui, à ma connaissance, n'avaient
jamais servi. J'ai su plus tard qu'un ordre venu de haut avait
obligé tous les gens à livrer les armes en leur
possession.
Je ne sais plus comment nous passâmes la nuit. Mais le matin,
c'était le grand calme. Personne n'osait sortir : on attendait
un événement. Soudain éclatent des applaudissements
et l'on entend des cris de triomphe : " Kampuchéa
libre ! " Par les fenêtres fermées, nous voyons
la foule des badauds et des sans-abri qui traînaient tout
le jour à travers la ville former une haie de chaque côté
de l'avenue : au milieu de la chaussé, en file indienne,
des gamins en veste et pantalons noirs, chaussés de bouts
de pneu transformés en sandales, l'arme à l'épaule,
avançaient en silence, sans un sourire, sans un regard
ni à droite, ni à gauche. Ils se dirigeaient vers
le centre de la ville. Je n'avais pas vu, mais ma soeur me fit
remarquer une jeep en tête, surmontée d'un drapeau
blanc. Aussitôt mon père et mon oncle, déchirant
un drap, en font un drapeau blanc qu'ils fixent à la fenêtre.
Pour sortir dans la rue, ils troquent leurs pantalons trop "
bourgeois " contre un drap qu'ils se nouent autout des reins
" à la Ghandi ". C'était donc ça
la libération ? Soudain, je les entends rentrer précipitamment
et fouiller dans la saile de bains pour trouver une grande serviette
de toilette... rouge. " Le drapeau rouge est apparu, il faut
mettre un drapeau rouge, sinon ils vont piller la maison ! "
Les gamins-soldats n'avaient pas l'air de vouloir piller, ils
avançaient, silencieux, sans rien voir ni personne. Mon
père agite son drapeau rouge : à la suite des soldats
s'avançaient des hommes qui semblaient un peu plus âgés
: ils étaient aussi habillés de noir, mais leurs
tenues étaient sales, crasseuses même. L'un d'eux
nous crie : " Nous venons vous sauver " ou " vous
aider ", je n'ai pas très bien entendu. Mon père
ouvre la porte et fait mine de surtir pour le saiuer : "
Ne sortez pas ! Nous allons d'abord nettoyer la ville : il v a
des bandits qui dévalisent les magasins. " En effet,
nous avions entendu dire qu'à la faveur des bombardements,
dts gens pillaient les boutiques, les épiceries, les bijouteries.
Vers midi, nous ailions nous mettre à table, une moto stoppe
devant la maison. Mon père va voir, je le suis : c'est
un Khmer rouge. " Préparez vos bagages, dit-il. Il
faut vous mettre en route le plus vite possible. Vous partez à
deux ou trois kilomètres d'ici, on vous dira. Nous devons
nettoyer la ville. Et surtout ne vous avisez pas de vous cacher
dans la maison ! "
Chacun prépare son baluchon. Nous mangeons un peu de poisson
grillé et du riz. Nos parents préparent les bagages.
Mon père réussit encore à acheter vingt pains
et du beurre. Ma mère et ma tante sortent des ballots enveloppés
dans des couvertures : on va les suspendre aux deux bouts de perches
de bambou que les adultes porteront sur l'épaule. Le tout
est rassemblé devant le perron.
Le soir tombe, c'est le silence. Dans le voisinage, on entend
des chiens pleurer. Nous attendons : peut-être n'aurons-nous
pas besoin de partir. En tout cas, rien ne presse : des milliers
de gens sont passés devant notre porte vers la sortie de
la ville, puis plus rien. Les enfants restent dans la maison,
couchés sur les tapis et les fauteuils. Nos deux pères
se sont installés, avec des couvertures, derrière
le portail qui donne sur la rue. Moi, je suis allée me
blottir près de la dôtùre du jardin, j'avais
peur, je tremblais dans la nuit moite.
Soudain, des cris, des coups de pied dans le portail de nos voisins
: " Sortez ! sortez ! " Personne ne sort, la maison
est apparemment vide. Je prie le Ciel qu'on ne nous voie pas.
Ils s'arrêtent devant notre portail : " Il y a quelqu'un
? " Pas de réponse.
Pourvu qu'ils ne forcent pas le portail ! Non, les pas s'éloignent.
Chacun a dormi comme il a pu. Mais dès le chant du coq,
ma mère nous réveille : il faut quand même
partir. Nous refaisons quelques bagages, noués dans des
draps. Chacun reçoit une charge de riz qu'il faudra porter
sur la tête.
Le soleil à peine levé, passe un Khmer touge :
- Allez, allez, il faut partir !
- Mais je ne sais pas où aller, dit mon père.
- A trois kilomètres de la ville. Allez, allez, on va nettoyer
la ville. Après ça, vous reviendrez, c'est l'affaire
de deux ou trois jours.
............................................
Extrait 2 : Septembre 1977
A Sroko Trobek, le groupe des jeunes filles semble se spécialiser
dans la construction des routes de terre. Dans un pays où
le sol est tantôt boueux jusqu'à un mètre
de profondeur, sinon plus, tantôt couvert d'une couche de
poussière où les jambes s'enfoncent à mi-mollet,
c'est une entreprise qui demande la mobilisation permanente d'une
armée de spécialistes comme nous, munies de nos
paniers de jonc et pourvues de mains infatigables.
Pour le moment, je suis immobilisée, ma jambe infectée,
sans l'espoir de trouver le moindre médicament. Mais voici
que je rêve de mon père. Il me dit : " Prends
du cérumen de ton oreille et applique-le sur ta blessure
infectée. Ne prends pas le cérumen d'une autre personne.
"
Le conseil m'a paru étonnant, mais je me suis exécutée
: le résultat était là. En trois jours, ma
jambe a guéri. La première étonnée
a été ma Mékong, persuadée que j'avais
adroitement simulé, et décidée à ne
pas me manquer à la moindre défaillance. Mes compagnes,
à qui j'ai dit comment j'avais fait, ont ri de bon coeur,
me traitant de farceuse. Je n'y puis rien. J'ai repris le travail
sur une nouvelle route en construction vers Don Trieh.
Les Mékongs sont toujours près de nous : "'
Allez, allez, il faut se dépêcher. La route doit
être prête au moment où l'on va planter le
riz. Il faut foncer ! " C'est leur mot favori.
Ils nous font travailler même la nuit, dès qu'il
y a un rayon de lune et souvent à la lumière de
lampes à essence. Si encore ils nous donnaient à
manger : une louche de liquide à midi, une autre le soir,
c'était tout.
Au bout d'un mois, j'ai eu l'impression que ma vue baissait. Je
creusais le sol à la pioche. Il n'était pas nécessaire
de regarder tout le temps. Mais, la nuit, quand il fallait ramasser
la terre dans mon panier et la porter sur le remblai, il fallait
pouvoir se guider : je ne distinguais rien. Je devais tâter
le sol, au risque de recevoir un coup de pioche sur la tête.
La Mékong disait : " Met Peuw fait semblant. Elle
dit qu'elle n'y voit plus, comme elle disait qu'elle ne pouvait
plus marcher. Viens avec moi ! " Elle me prend par la main
et me conduit au milieu de la route. Je pensai que j'étais
bonne pour le sac en plastique. Mais cela m'était bien
égal. Elle me laisse au milieu de la route et me dit :
" Je m'arrête un instant sous le buisson. " Je
ne sais où me diriger. J'attends. Puis je tâte le
sol : ce n'est pas de l'herbe, ce n'est pas du caillou. De la
terre !
Je tâte autour de l'endroit où la Mékong m'a
laissée. Ma main remonte sur un petit tertre : une tombe
! Je m'assieds sur le bord de la tombe. La Mékong va revenir.
Mais non ! Une heure se passe, puis deux. L'aube approche, c'est
l'heure où les travailleuses reviennent pour environ quatre
heures de repos. J'entends pas ser un groupe, j'appelle. Une de
mes compagnes me reconduit à ma hutte et me dit : "
Tu étais au milieu des tombes. La Mékong a voulu
sans doute vérifier si tu y voyais. Si tu avais eu peur,
tu serais accourue à ta cabane, et aiors elle t'attendait
avec une pioche. Pas pour creuser la terrre. "
Le soir de ce jour-là, après le travail normal que
j'ai dû assurer dans la journée, à la séance
d'éducation, le Mékong-chef dit publiquement (tout
est public ici) : " Met Peuw sera dispensée du travail
de nuit, elle n'y voit vraiment pas. "
Trois jours plus tard, nous avions achevé une section de
la route.
Une journée libre pour tout le monde : " Vous pouvez
aller dans vos villages. " J'aurais aimé aller à
Wath Tia, voir Tôn Ny ou prendre de ses nouvelles. J'aurais
voulu savoir comment vivait Srei Peu toute seule à longueur
de journée. Ne voyant pas clair, je n'ai pas osé
me mettre en route.
Rentrées dans la nuit, quelques-unes de mes compagnes ont
raconté qu'à Wath Tia on mangeait mieux. Les travailleurs
ont du riz consistant et même parfois des morceaux de porc.
A la séance d'éducation du soir, le Mékong-chef
annonce que si quelqu'un veut aller travailler à Wath Tia,
il n'a qu'à le dire.
Il sait qu'on y mange mieux et que l'on n'a pas besoin d'y travailler
la nuit. Il comprend cela.
- Vous avez d'ailleurs le témoignage de celles qui sont
allées hier à Wath Tia. Qui est-ce qui est allé
à Wath Tia hier ?
- Moi, moi, disent quelques voix.
- Est-ce qu'on y mange bien ?
- oui, oui.
- Qui veut aller à Wath Tia ?
Cinq mains se lèvent.
- Vous voulez vraiment ?
- oui, oui !
- Eh bien, allez prendre vos affaires.
La Mékong les accompagne. Elles ne sont jamais arrivées
à Wath Tia.
..................
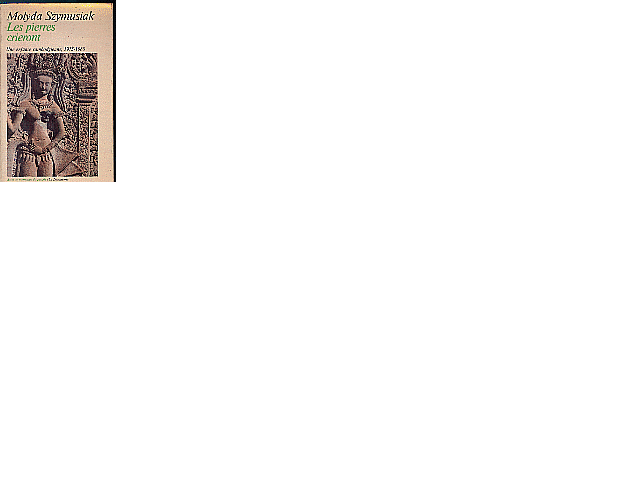 Unique survivante de sa famille, Molyda a dicté à
ses parents adoptifs le récit de l'agonie des siens sous
le régime des Khmers rouges. Elle avait douze ans lorsque
les troupes de Pol Pot occupèrent Phnom Penh le 17 avril
1975.
Unique survivante de sa famille, Molyda a dicté à
ses parents adoptifs le récit de l'agonie des siens sous
le régime des Khmers rouges. Elle avait douze ans lorsque
les troupes de Pol Pot occupèrent Phnom Penh le 17 avril
1975.